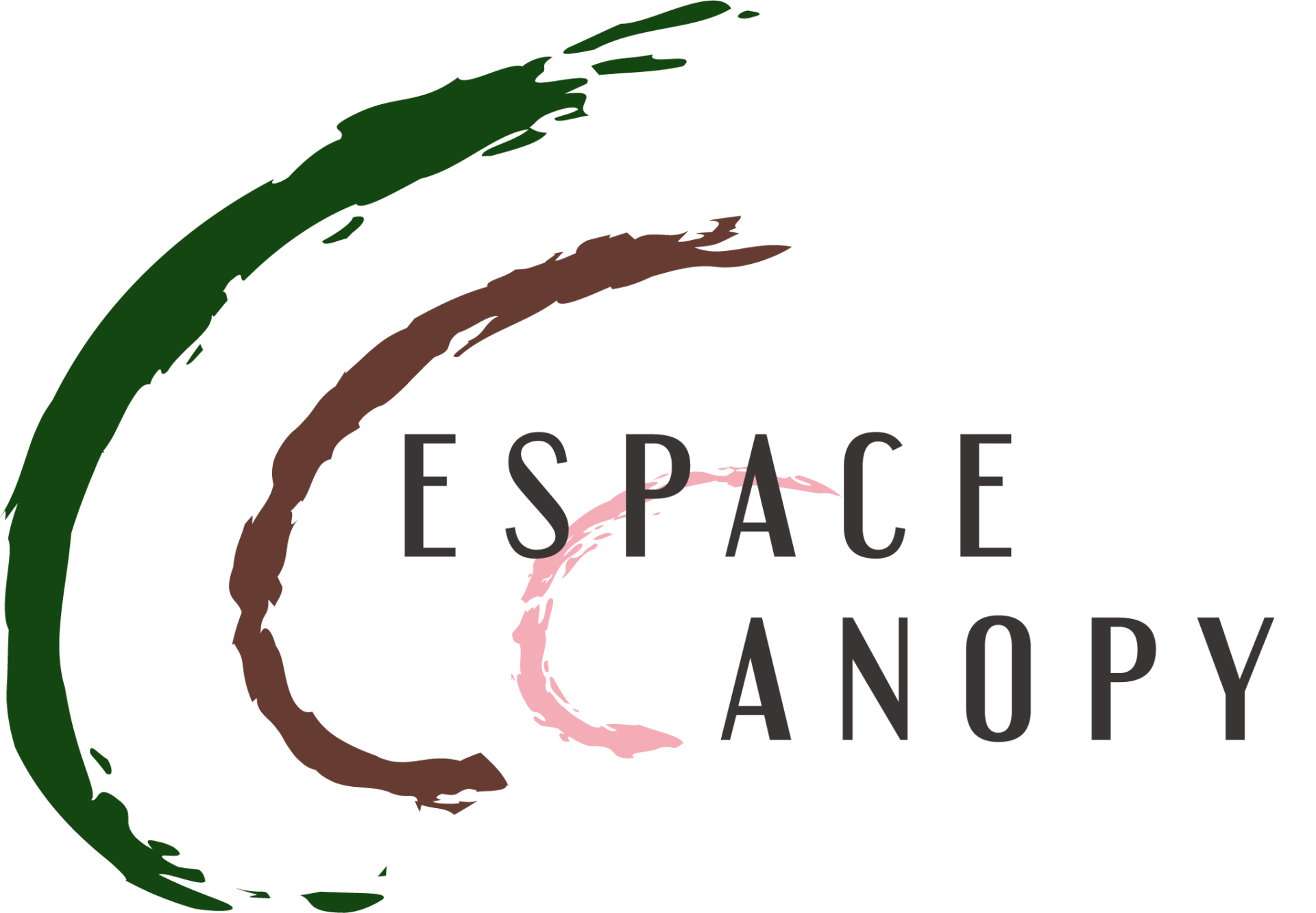Henry Hang : Peintre et danseur à vie
Deborah Gallin • 12 juin 2020
Henry Hang est fier de son pedigree hip hop. C’est le moins que l'on puisse dire. Toujours danseur hip hop (il a commencé à danser en 1988) et graffeur à une époque, il maîtrise l’huile, l’acrylique, l’aquarelle et la bombe aérosol et peint sur tous les supports qu’il trouve : les murs, le toiles, les habits.
Venez à la rencontre de cet artiste passionné.
DG : Comment tu es rentré dans ce monde ?
HH :
Ma mère était photographe. J’ai grandi avec tout ça. J’ai fait des études de photographie quand j’étais plus jeune et développé les photos à la maison.
J'étais beaucoup attiré par le dessin de la BD. J’allais la bibliothèque, je regardais les BD, je recopiais, je refaisais tout. On allait au Louvre. J'étais partagé entre les grands peintres et la BD. J'ai mélangé les deux arts. J'ai commencé par le dessin. J'avais une vision photographique des choses et la façon dont je peignais était plutôt photographique.
Naturellement, j’aimais le hip hop, j’étais aussi danseur.
DG : Qu'est-ce qu’il y avait dans le hip hop qui te touchait?
HH :
Danser ! C’est ce qui m’a toujours le plus touché. J’étais danseur hip hop et je danse toujours. J’aime quand ça bouge, quand il y a beaucoup de mouvement. Quand on danse on est libre. C’est ta personnalité, ta culture, ta manière de bouger que tu ramènes et que tu transmets . C'est la culture que je transmets et cette liberté de créer chaque jour sans contrainte.
DG : La liberté est un mot qui revient souvent quand je parle aux street artistes.
HH :
Oui, c’est la liberté ! Tout ce qui est académique a un droit d’entrée soit à cause de l’argent parce que l’école coûte cher, soit il faut avoir le bagage intellectuel ou tout cela. Ce sont les contraintes qui font que certains ne peuvent pas y accéder facilement.
Avec le hip hop il n’y a pas de barrière : ni financier, ni social, ou autre. Avec le street art et avec le hip hop on est libre…de dessiner ce qu’on veut et où on veut. C’est la raison qu’on parle de liberté.
DG : Tu parles souvent de graff et graffiti. Pourquoi ?
HH :
Je parle beaucoup de graffiti parce que ça me rapproche de ce que j’ai vécu dans le hip hop et parce que le graffiti m’a amené à peindre aussi. Quand j’ai commencé à peindre on parlait de graffiti. Ce n’était pas de street art. Ce mot est venu plus tard. J’ai dû inventer un nouveau terme pour me définir. Je faisais du tag mais j’aimais peindre sur les toiles aussi. Ce que j’ai vu au Louvre m’intéressait beaucoup.
J’ai mélangé le hip hop et le graffiti. Quand on me demandait ce que je faisais, je ne pouvais pas dire que je faisais du hip hop parce ce n’était pas du hip hop et je ne pouvais pas dire que je faisais du graffiti parce que ce n’était pas du graffiti. J’appelais ce que je faisais du hip hop art.
Je n’arrive pas à dire que je suis dans le street art. Les gens sentent que je ne rentre pas dans ce cas. Je viens d’une branche de graffiti de la culture hip hop. On oublie souvent que le graffiti fait partie de cette culture. On peut dire que je suis en mode résistance : hip hop dans l’esprit du hip hop. Je parle du hip hop et d’être danseur hip hop. Je peins les danseurs et je fais du graffiti. Je danse et je peins. Je suis vraiment dans cette culture ! C’est très rare qu’on voit des artistes comme moi.
DG : Le hip hop est bâti sur quelles valeurs ?
HH :
C'est un métissage culturel. Au départ c’était du genre « peace and love." On peut venir de la France, d’Afrique du Nord ou d’un autre pays, on peut être Anglais ou Américain. On vient avec sa propre culture et on mélange les cultures pour donner la couleur du hip hop. On vient peut-être avec des problèmes familiaux ou des problèmes personnels mais on sait que son énergie négative sera transformée en énergie positive. On se bat avec son art en faisant les défis avec les autres toujours dans la paix. Ce sont les valeurs du hip hop.
DG : Tu « fais un lien entre l'écriture et la grammaire de l'art contemporain avec l'énergie du graffiti. » C’est quoi « l'écriture et la grammaire de l'art contemporain ? »
HH :
Il y a un côté classique en l’art contemporain et en la peinture contemporaine. Elle a une école et une manière de fonctionner propre à elle.
Je fais un pont qui permet aux gens d’admirer, même de comprendre ce que je peins. Je mélange les techniques de peinture classique et les techniques de graffiti. C’est-à-dire, j’applique cette manière académique de peindre sur mes œuvres tout en mélangeant une culture non-académique, l'esprit urbain de cette culture urbaine. Les deux peuvent se rencontrer sur la même toile.
DG : On parle du graffiti et de street art comme « le mouvement urbain fait d'une polyvalence et de la créativité. » Où est la rébellion dans tout ça ?
HH :
La rébellion vient surtout du fait qu’on n'est pas académique. Il n'y a pas d'école et on ne va pas suivre des codes stricts des écoles. On se rebelle sur les supports aussi : le mur. Qu’on peint sur un mur, il n'y a pas d'autorisation. On part, on le sent, on le fait. Peu importe ce qu’on met. Ce qui est important est qu'on le ressent.
C’est libre au spectateur de dire j'aime ou je n’aime pas, je comprends ou je ne comprends pas, j’adhère ou je n’adhère pas.
Même quand qu'on fait un tag sur un mur, on ne va jamais expliquer ce que ça veut dire. C'est celui qui connaît cette culture qui va savoir ce qui est écrit. Quand on parle de graffiti on parle plus de rébellion que de graffiti. Le street art est beaucoup plus accessible que le graffiti est plus facile à comprendre.
DG : Tu dis « mon art est à vivre ». Ce sont les autres qui vivent ton art quand ils le voient ? Ou c’est toi qui vit ton art en le faisant ?
HH :
il faut dire que c’est les deux. Je ne peins pas forcément que pour être dans une galerie ou dans un musée. Mon art est accessible et il est polyvalent. Je n’arrête pas sur un support. Je peins sur la toile, sur des objets, et sur les habits. On vit avec.
L’art n’est pas fait pour être enfermé. Tout est art : on peut être interpelé par la forme d’une flaque d’eau ou d’un nuage. Ça fait partie de la vie. Mon art aussi, il est à vivre. Il faut que les gens profitent de cet art. Autant je vais faire des prix qui peuvent être très chers autant je vais faire des prix qui peuvent être accessibles à tout le monde. Chacun a le droit de me demander selon son désir, selon son prix, selon ces choses. Je lui ferai profiter parce que ça le touche.
DG : Comment ton art est un art contre-courant ? Ce n’est pas contradictoire à dire que tu fasses un art contre-courant ?
HH :
Effectivement, ça peut être contradictoire et je veux être contradictoire. Je ne rentre pas dans le cadre des graffeurs classiques. C'est ma volonté depuis longtemps : ne pas être enfermé avec la bombe aérosol et faire que les ponts et que les murs. Je ne voulais jamais faire que ça.
C'est la raison pour laquelle très, très tôt, j'ai peint sur les toiles alors que mes copains étaient encore sur les murs et taguaient sur les trames. J'ai dit OK, j'ai fait ça, mais je vais arrêter. Je savais que la plus belle des peintures, la plus forte des peintures est l’huile sur toile. Je me suis dit, je veux le top, je veux l’huile et après je vais revenir à la bombe. J'ai toujours navigué à contre-courant. J'ai toujours été à l’aise là où on ne m’attend pas. Pourquoi? Il faut toujours étonner les gens. Un artiste doit surprendre, et moi je veux surprendre. Il coûte très cher de surprendre, d’être mis un peu à part des fois mais c’est ma manière de vivre. Mon but n’est pas forcément de plaire à tout le monde. Mon but est le partage.
Quand les gens veulent comprendre la culture urbaine, le street art, ils vont sur internet. Mails il n’y a pas une histoire de street art, de graffiti ou de hip hop, il y a DES HISTOIRES. Il y a beaucoup de gens et chacun a son histoire. Ceci explique pourquoi les artistes parlent de la liberté. Quand on est libre on fait ce qu’on veut et c’est à cause de cela qu’il y a des histoires. J'ai débuté en peinture entre 1994 et 1997 et le graffiti plutôt en 1994. Je dansais du hip hop déjà en 1988. Les gens m’ont connu peintre et ils m’ont connu danseur. C’est mon histoire que je raconte, je ne suis qu’une version.
DG : Cette phrase décrit ta manière de peints « la peinture figurative s'appuie sur les bases de l'histoire de l'art classique, reprenant le mouvement du réalisme avec des œuvres fortement marquées par le bitume au rythme de la cadence du danseur. » Y-a-t-il des artistes classiques, contemporains, modernes ou de toutes sortes qui t’ont influencé plus que d'autres ?
HH :
Oui, le peintre David qui a fait Le Sacre de Napoléon, dont son côté réaliste et les détails dans ses peintures qui m’ont beaucoup touché. Les couleurs qu’il utilisait, la profondeur de ses œuvres, ce sont les choses qui m’ont beaucoup influencé. Il y a aussi le peintre Géricault. Par exemple, Il est parti à l'hôpital la Salpêtrière voir les cadavres décomposés pour pouvoir faire ses couleurs dans Le Radeau de la Méduse. Cette recherche des informations et cette manière de faire des recherches m’ont aussi poussé. Même Charles le Braun, le peintre de Louis XIV. Tous ces peintres ont énormément influés mes compétences dans la peinture. Comment faire ressentir des émotions ou du mouvement dans une toile.
Il ne fallait pas que je peigne pour peindre. Il fallait raconter une histoire.
Je n'ai pas fait d’école d’art ni histoire de l'art. Quand j’allais au Louvre, j'écoutais les historiens parlaient aux groupes et je comprenais comment faire pour peindre. Il fallait raconter une histoire.
J’ai compris la technique aussi. Comment ils ont réussi à faire de velours, de tissus, peindre de tissus en soie. Il fallait que je me document que j’aie chercher des informations sur des techniques de peinture.
Parmi les artistes modernes ou contemporains il y a l’Italien Alessandro Papetti qui peints des immeubles des villes comme Milan et Paris. Il peint dans le vif
sans trop de détails dans la vitesse ! Cette manière de peindre m’a aussi beaucoup influencé. Je me suis dit je ne suis pas oblige de faire tous dans les détails.
Les Impressionnistes m’ont fasciné, comme Turner. Lui aussi c'est vraiment la couleur du coucher du soleil, se peindre une toile vite comme si c’était de l’aquarelle. Pour moi, c'était époustouflant !
En termes de graffiti celui qui m’a impressionné est MODE2. Il m'a beaucoup, beaucoup influencé. En band dessine, c’est le créateur Frankin et le personnage Gaston Lagaffe. Ce sont les artistes soit moderne, soit graffeur, soit de BD, soit les peintres anciens qui m’ont influencé de peindre de manière très propre. J’ai gardées tous ces influences toute en mettant mon style.
DG : Comment décris-tu ton style ?
HH : Je n’arrive pas à mettre un nom sur mon style ni à me définir. Les autres peuvent mieux en parler. Quand on parle de picturale on reconnait mon « style. »
J’aime bien ce style un peu impressionniste, ou mélanger un peu deux styles : impressionnistes et des fois un peu de réalisme. Mais je ne veux pas que ce soit défini comme une photo. Sinon autant prenne une photo. Je préfère qu’on reconnaisse bien qu’il y a quelque chose au même temps mais il faut que ce réalisme ne soit pas trop. Il faut qu’il y soit du mouvement et du dynamisme même
dans le regard d’un portrait. Il faut qu’il y ait un échange fort
avec le spectateur.
DG : Comment as-tu fait la transition de la rue à autant d’activités dans le moule académique : tu es un expert en art urbain et du graffiti sur toile, tu enseignes, tu fais de curation ?
HH :
Je suis arrivé à un moment quand des amis danseurs rentraient dans une école d’art pour pouvoir avoir un diplôme. Afin d’avoir son diplôme il fallait qu’un ami, Anthony Benchimol, danseur du crew Division Alpha écrive un mémoire. Il ne sentait pas la force de l’écrire. Il proposait à la directrice de faire un exposée vivant. Il lui a dit je vous ramène des gens qui vont parler à ma place il vont vous parler de ma culture et de leur culture. Il m’avait amené ainsi que Kongo du crew Mac.
Chacun de nous a décrit notre carrière, de ce qu’on fait. La directrice a beaucoup aimé mon discours et elle m’a demandé de rester un mois afin d’enseigner. Elle m’avait demandé d’enseigner les gens sur votre art que nous ne connaissons pas. Cette école formait les futurs galeristes et futurs commissaires d'exposition et ils ne connaissaient pas de tout cette culture.
J’ai décidé de les aider un peu, de donner un coup de main. Je me suis dit je vais rester un mois ou deux. Au bout de 20 mois, la directrice me dit il faut qu’on vous garde parce que ce que vous faites et ce que vous transmettez est très, très bien. En plus, ça va exploser et on va parler beaucoup de cette culture dans l'avenir.
J’étais d’accord. C'était le moment de transmettre. Il fallait savoir que le street art ou le graffiti (on l’appelle comme on veut) n’allait pas rester que dans la rue. Je savais que ça allait exploser, ça allait s’éclore. Au moment qu’elle m’avait demandé, il y avait déjà des écoles comme les Beaux-Arts qui faisait une session street art. Sciences Po faisait également des expos street art dans leurs locaux et des interviews auprès de certains graffeurs.
Il était très important de transmettre même dans un environnement académique. Je n’expliquais pas comme les galeristes qui prenaient un artiste et l’utilisaient comme exemple pour tout décrire. Je commençais avec le hip hop en France : quand et comment c’est arrivé. Le côté social : pourquoi il y a des graffeurs, pourquoi il y a des danseurs, pourquoi tout le monde se connait dans le graffiti. Qu’est-ce qui a poussé les gens dans la rue pour graffer. Comment on graff dans le métro. Comment on fait pour tagguer sur les parois du métro. Je leur ai parlé de tout parce qu’on ne le dit pas.
Je voulais leurs faire vivre ce que j’ai vécu. Il ne fallait que leur raconter mon histoire. J’ai ramené les artistes dans la classe tous ce qu’on voyaient sur YouTube. Les gens qui vivaient cette culture parlaient eux même du street. En plus, ces artistes pouvaient faire des projets avec les gens de l’école et être payés pour ces projets. Ce n'était pas seulement pour les artistes parce qu’ils avaient besoin de projets pour vivre. Tout le monde gagnait.
DG : Avant l’arrivée du Coronavirus, comment tu voyais ton évolution et celle du graff et du street art dans le monde de l’art et dans un monde consommateur ?
HH :
Je voyais déjà que par des maths. On était trop mercantile, on parle trop d'argent et pas assez d’art. A une époque aux ventes aux enchères on vendait beaucoup plus d’artistes différents, de styles distincts, on voyait les différences et c’était beau. Avant Corona les ventes aux enchères avaient déjà changés, on allait plus vers des gens qui vendaient très, très cher et qui sont connus dans le monde entier. Ce qui fait que les artistes avait beaucoup de mal à vendre.
Corona a changé la donne et je pense qu'il y aurait de changements vis-à-vis des galeries. C’est-à-dire que, les galeries avaient l’habitude de vendre leurs artistes. On va retrouver des ventes d’œuvres beaucoup plus authentiques moins basé sur le profit. Les gens vont se retourner et voir qu’il y a d’autres artistes qui existent également parce qu’ils n’iront plus aux mêmes galeries avec les mêmes expositions. Il faut aussi que les gens s’ouvrent à cette culture qui est très accessible même en termes de vente. Il y a beaucoup d'artistes qui sont bon et très forts.
HH :
On reste bloqué sur les galeries parce que les galeries ont un certain pouvoir. Ils ont de l'argent mais il n’y a pas que ça ! Il y a d’autres valeurs. Il y a pas mal de galeries physiques qui ont chuté. Ils ont gardé des galeries virtuelles. Et ces galeries virtuelles qu’est-ce qu’elle propose ? Les gens qui vendent des œuvres sur Internet sont-ils issus de cette culture urbaine ? Ça n’existe pas. Est-ce qu’on peut aller directement voir un artiste pour acheter ces œuvres ? Est-ce que le collectionneur est obligé d'aller voir une galerie ?
J’ai reçu des appels de gens qui m’ont dit ça fait deux mois que je n'ai pas dépenser de l'argent parce que je voulais avoir un de tes œuvres. Je ne pouvais pas sortir donc j’ai de l’argent. Je vais passer voir si je peux acheter un de tes œuvres. C’est très rapide. Les gens vont aller voir les artistes directement.
Ce que je vois après Corona est malheureux quand même. Je ne me réjouis pas pour les artistes qui perdront leur clientèle, qui ne sont plus en galerie. On est tous artistes, on a tous vécu ce virus et je voudrais que tout le monde puisse en sortir. Mais je m’envieux un peu aux galeries. Certaines connaissent l’histoire de cette culture d’autres non mais ils ne donnent pas la possibilité de s'exprimer. C'est dommage parce que ce monde est trop égoïste. Et sur le coup de Corona ce sera beaucoup mieux pour tout le monde si tout a été redéfini.
HH :
L'enseignement sera beaucoup plus accessible
qu’avant le virus.
On commence à voir des écoles qui s'ouvrent par rapport à la culture hip hop.
On voit très bien qu’il y a des métiers qui n'existent pas.
Il faut retrouver tous les métiers de l'art contemporain dans l’art urbain ou la culture urbaine aussi, par exemple : un Expert en Art Urbain. Actuellement quand on parle d’Expert en Art Urbain ce sont des collectionneurs qui sont « experts. » Ce n’est pas parce qu’il collectionne 20 ou 40 œuvres qu’il est expert en art urbain. Les experts sont les gens qui l’ont vécu. Même s’il n’ont pas été peintre. Il y a des métiers comme les avocats spécialisés. Des Agents d'Artistes ? Ça n’existe pas. Les gens qui vendent des œuvres sur Internet sont-ils issus de cette culture urbaine ? Ça n’existe pas. Ou sont des collectionneurs qui ont vécu cet art urbain et qui font sa promotion ? Il y a pas mal de choses à faire.
DG : Je lisais une tribune qui parlait de ce qui pouvait se passer dans le monde de l’art après le COVID. Je l’ai trouvé tellement pessimiste.
HH :
Un galeriste va regarder ces collectionneurs et ces murs. Il va dire, il faut que je paie le loyer, il faut que je paie l’électricité, j’ai plein de choses à payer. Il est un marchand. Aujourd'hui, on vient à des choses terre à terre. Allez voir directement les artistes. Le COVID est passé et on n’est plus confiner. Redéfinissons le marché.
Les artistes vendront directement leurs œuvres. On aura le prix de l’artiste, ce sera moins cher.
DG : De quoi es-tu le plus fier ?
HH :
Mon indépendance au marché. J’arrive à vivre de mon art sans répondre au marché, sans correspondre au marché, sans qu’on me dise il est bon cet artiste, c’est un vrai graffeur. Je ne correspond pas vraiment au graffeur. Je réponds complètement à la culture urbaine. Je suis en pleinement dedans. Je ne suis pas débutant. Ça fait 26 ans que je peints. Peu importe ou on ira on dira lui il connait son domaine. Je peigne à l’huile, je peigne à l'acrylique, je peigne à l'aquarelle, je peigne à la bombe aérosol. Je peints sur tous les supports : je peigne sur mur, je peigne sur toile, je peigne sur les chemises, je peigne sur tout. Je sais fier de mon indépendance.
Le plus important est de faire comprendre que la culture urbaine n’est pas limitée au street art et au graffiti il y a aussi cette culture hip hop. Il faut toujours la mettre devant les yeux. Il faut que les gens comprennent que c’est la culture « hors airs » grâce auquel nous avons tous connu le graffiti. Tout graffeur sait que la culture et le graffiti ne sont pas venue toute seule, ils sont venus avec le hip hop. C’est cette faite que les galeristes et le reste du marché essaient d’étouffer.
Je suis content aujourd’hui parce qu'il y ait beaucoup de jeunes qui sortent des écoles, qui peigne mieux que moi, qui font les graffs plus beaux que les autres. Je suis très content. Il faut que ça continue. Je ne suis pas du style à dire avant c’était mieux. Avant était différent. Aujourd'hui est différent. On a besoin que les jeunes s'approprient tout ça. Pourquoi? Parce que c'est l’avenir. Il faut que les jeunes soient là pour portent le poteau au plus jeunes.
Il faut aussi qu’il ait un nouveau moyen de vente pour que les gens puisse vivre de l’art, que l’art soit plus accessible pour tous et que ce soit un échange ! Pour que tout le monde y gagne, que l’art ne soit pas la chasse gardée seulement pour les riches qu’il y a tout sorte de prix. C’est ce qui est important pour moi.
DG : As-tu participé à peindre ce mur ?
HH :
Non je n’ai pas participé. Je connais les artistes. C'est un très beau mur parce que ce sont des personnes très, très talentueuse et très douées. Beaucoup de gens ne comprennent pas la fresque murale et ne savent pas l’expliquer. C’est mieux qu’un artiste explique ce qu’est cet art, le graffiti.
Vous pouvez voir les œuvres murale d’Henry Hang
à Créteil (l’école primaire Sarrazin ; Quai de la Croisette, lac de Créteil ; Mairie de Créteil), Copacabana Rio de Janeiro, Evry, Rouen, Paris 11ème, Paris 20ème. Il faut savoir que les fresques sont parfois éphémères et recouverte.
Vous pouvez aussi apprécier ses réalisations sur son site www.henryhanglabo.com.
Deborah Gallin
est la Fondatrice d’Art Works Internationally : Libérez l’inattendu.
Autres articles...

Ateliers de Conversation en Anglais avec Lisa Fleury Lisa Fleury, bénévole passionnée, anime les ateliers de conversation en anglais à l’Espace Canopy. Dans cet entretien, elle nous partage son parcours au sein de l’association et les motivations qui l'ont poussée à offrir son temps et ses compétences pour animer ces ateliers destinés à nos seniors. Voici un entretien que nous avons eu avec Lisa, où elle nous raconte en détail son expérience et son travail avec les participants de ses ateliers. ~~~ Qu’est-ce qui vous a poussé à faire du bénévolat à Espace Canopy et à enseigner l’anglais aux seniors ? Après avoir participé à de nombreuses sorties et visites d'expositions avec Escap'Art, j'ai reçu un courriel d'Espace Canopy me demandant si des anglophones souhaitaient organiser un atelier de conversation en anglais, parce qu’ il y avait de la demande. Les gens que j'avais rencontrés à l'Espace Canopy étaient si ouverts et gentils, et j'étais très reconnaissant pour les généreuses opportunités d'Escap'Art, j'ai donc décidé de me porter volontaire pour organiser une séance d'anglais. Je voulais aussi mieux connaître des Français. Notre première séance d'atelier de conversation en anglais était tellement amusante et les participants tellement enthousiastes que j'ai eu envie de continuer ! Je reçois tellement de satisfaction d’être avec ce groupe.

L’exposition Festival of Collage à la galerie Canopy met en lumière les possibilités infinies que ce médium artistique a à offrir. L’artiste Petra Zehner, également fondatrice du Paris Collage Collective à l’origine de cette exposition, nous confie : « J’ai toujours aimé l’idée de travailler avec d’autres artistes. À l’époque, ayant récemment déménagé en France, je ne parlais pas français. Ce qui m’a amenée à créer un groupe dont je pouvais faire partie. Je voulais entrer en contact avec de nombreux autres artistes et j’ai découvert qu’avec une communauté, il était plus facile de se connecter avec les gens. Cette expérience est également la raison pour laquelle le slogan du Paris Collage Collective, inclusif et non exclusif, transmet exactement ce que nous essayons de créer : un espace sûr et ouvert à la créativité. » Le collectif rassemble des artistes de près et de loin notamment grâce à son fort engagement sur les réseaux sociaux accessibles au public du monde entier. Leur site web propose des défis de collage hebdomadaires pour inciter chacun à participer. Cela permet au public de devenir plus curieux de voir la variété des interprétations qui ont été prises à partir du point de départ donné. ~~~ The Festival of Collage exhibition at the Canopy gallery brings to light the infinite possibilities this artistic medium has to offer. The artist Petra Zehner also founder of the Paris Collage Collective behind this exhibition tells us “I always liked the idea of working with other artists. At the time having recently moved to France I didn’t speak French. Which led me to create a group that I could be part of. I wanted to reach out to many other artists, and found that with a community it was easier to connect with people. This experience is also why the Paris Collage Collective’s slogan inclusive and not exclusive summarises what we’re trying to create : a safe and openminded space for creativity.” The collective brings together artists from near and far notably through their strong engagement in social media that is accessible for a worldwide public to discover. Their website offer weekly collage challenges to incite anymore and everyone to participate. This creates anticipation for the public in seeing the variety of interpretations to the given starting point.

L’activité de Slow Looking dirigée par Mary-Jane et Nita explore la connaissance de soi et la perception d’autrui. Elle est en lien avec notre exposition photographique "WHO’S NEXT" de l’artiste Charlotte Haslund-Christensen qui orne nos murs. Elle a commencé avec une petite introduction méditative, afin de nous apaiser en contrôlant notre respiration et pour être conscient de notre corps.